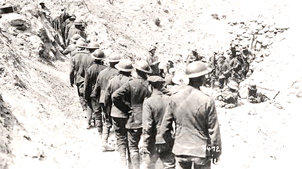© CDHS - SAINT-CLEMENT - 2019



© CDHS - SAINT-CLEMENT - 2019


Bienvenue
sur l’Espace de…
« Joson et La Poux »





























Le conflit de la Grande Guerre
(suite)

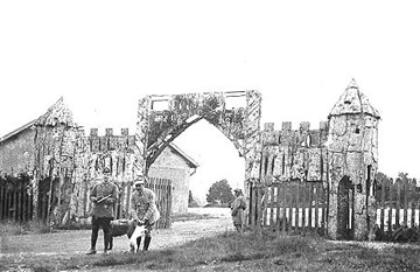
Porte du camp de Corcieux

Signature du Traité de Versailles

Saint-Jean d’Ormont (Vosges)
Mai 1915 : La Pêcherie (Vosges)
En 1915, l'armée lance une grande campagne de vaccination. On en profite parfois pour vacciner les civils qui vivent au contact des soldats. Dans cette scène, la présence d'une épaule féminine attire manifestement les regards.
Raymond
Poincaré
,
Président
de
la
République,
rend
visite
aux
troupes
françaises
stationnées
au
Rudlin
(Plainfaing)
en
juin
1915
avec
le
Ministre
de
l’Intérieur
Louis
Malvy.
Rudlin,
lieu-dit
de
ma
famille
Durain,
parents
maternels
de
Valérie
Barbier.
Joseph a onze ans en 1915 :
«
Maman : Mon maître nous dit que nous pouvons nous aussi faire quelque chose pour la France. Je suis très fière de chanter avec toute la classe des chants qui parlent de nos soldats, des Tontons, et de notre pays ».
En
1915,
le
ministère
de
l’Instruction
publique
lança
un
appel
à
propositions
pour
adapter
les
cours
de
l’école
primaire
à
la
situation
de
guerre.
Le
maître
d’école
racontait
aux
enfants
notamment
des
histoires
sur
des
Français
courageux
et
des
Allemands barbares, et leur chantait des chants patriotiques.
23 mai 1915 : L'Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie
Jusque-là
membre
neutre
de
la
Triple-Alliance,
l'Italie
fait
volte-face
et
déclare
la
guerre
à
l'Autriche-Hongrie,
le
23
mai.
C'est
le
début
de
la
guerre
dans
les
Alpes,
qui
doit
notamment
permettre
aux
Italiens
de
mettre
la
main
sur
certaines
terres
au nord de l'Adriatique (Trentin, Istrie, Dalmatie).
Septembre 1915 : Arrière-front des Vosges
Au
front,
une
part
des
vêtements
est
réglementaire,
une
autre
est
aléatoire.
De
bas
en
haut,
les
soldats
portent
des
brodequins,
des
bandes
molletières,
une
culotte,
une
vareuse
et
enfin
une
capote,
portée
par-dessus.
Le
sac,
ou
'barda',
peut
peser entre 20 et 30 kilos.
« Est-ce que Papa ou Tonton a encore ses deux bras? J’ai très peur pour mon père, qui est à la guerre. Tous les jours, je vois des messieurs bizarres dans les rues. Ils n’ont plus qu’une jambe ou un œil ».
Impossible d’ignorer les 60 000 mutilés de guerre, qui étaient présents partout. Les enfants comme Valérie, vivaient dans l’angoisse permanente que leurs pères ou tontons subissent le même sort.
21 février-18 décembre 1916 : bataille de Verdun
Le
général
Erich
von
Falkenhayn
entend
"saigner
l'armée
française"
.
Un
million
d'obus
pleuvent
en
24
heures
dans
le
secteur
de
Verdun
(Meuse).
Les
Allemands
progressent,
mais
des
poches
de
résistance
se
constituent
dans
les
lignes
arrière
françaises. Des hommes et du matériel sont acheminés en masse grâce à la "Voie sacrée" qui relie Bar-le-Duc à Verdun. Ce terme emphatique, référence à la "via sacra" romaine, est inventé par Maurice Barrès à la fin de la guerre.
La
bataille
de
Verdun
prend
fin
le
18
décembre,
date
à
laquelle
la
plupart
des
positions
perdues
ont
été
réinvesties
par
l’armée
française.
Au
total,
160
000
Français
sont
morts
ou
disparus,
143
000
chez
les
Allemands.
Plus
de
60
millions
d'obus
ont été tirés sur une période de dix mois dans "l'enfer de Verdun".
Printemps 1916 : Secteur de Saint-Jean d'Ormont (Vosges)
On compte une cuisine roulante par compagnie, soit 150 hommes environ. En première ligne, les soldats se contentent de pain et de conserves.
9 juin 1916 : Changez l'heure de vos pendules !
Ce
jour-là,
le
Petit
Journal
rappelle
à
l'ensemble
de
la
population
qu'elle
va
devoir
modifier
l'heure
de
ses
pendules.
En
effet,
cette
idée
a
fait
son
chemin
:
évoqué
par
Benjamin
Franklin
dès
1784,
un
changement
d'une
heure
en
été,
pour
vivre
plus
longtemps
avec
la
lumière
du
jour,
permettrait
de
faire
des
économies
d'énergie.
En
temps
de
guerre,
quoi
de
plus
légitime
?
Proposée
dès
1907,
l'idée
est
appliquée
par
l'Allemagne
fin
avril
1916,
aussitôt
suivie
par
l'Angleterre
en
mai,
puis
par la France en juin.
1er juillet-18 novembre 1916 : Bataille de la Somme
Alors même que l'Est de la France est sous un déluge de feu, une offensive franco-britannique est lancée sur le front allemand de la Somme, au nord de Paris. Des dizaines de milliers de Britanniques avancent dans le no man's land.
2 juin 1916 : Les Allemands bombardent le terrain de Corcieux
À
Verdun,
cette
bataille
est
la
plus
importante
de
la
guerre.
Pour
la
première
fois
de
l'histoire,
des
chars
d’assaut
(blindés)
sont
utilisés
par
des
militaires
(à
partir
de
septembre,
du
côté
britannique).
Les
combats
durent
jusqu’en
novembre.
Ils
font environ 300 000 morts Britanniques et Français, et près de 170 000 tués dans l'armée allemande.
6 avril 1917 : Les États-Unis entrent en guerre
Après ces revers, l'Allemagne réenclenche la guerre sous-marine à outrance dans l'Atlantique, début février. Les attaques visent, entre autres, les navires marchands américains. Dans son message au Congrès, début avril, le président Wilson
déclare : "La récente conduite du gouvernement impérial allemand n'est, en fait, rien moins que la guerre contre le gouvernement et le peuple des États- Unis". Le Congrès américain vote l'entrée en guerre le 6 avril.
16 avril 1917 : Bataille du chemin des Dames et mutineries
Reportée
à
plusieurs
reprises,
"l'offensive
Nivelle"
(du
nom
du
général
qui
dirige
les
opérations)
a
lieu
à
6
heures
du
matin
dans
le
secteur
du
chemin
des
Dames
(Aisne),
par
un
temps
glacial.
C'est
un
échec
sanglant.
Après
une
relance
le
5
mai,
le constat du fiasco est définitif trois jours plus tard. Le 15 mai, Nivelle est remplacé par Pétain à la tête de l’armée française.
Cette
défaite
donne
lieu
aux
premières
mutineries
dans
l'armée
française,
dès
le
17
avril.
Des
unités
complètes,
soit
30
000
à
40
000
soldats,
refusent
de
monter
en
ligne.
Des
dizaines
de
poilus
sont
alors
fusillés.
Au
total,
environ
740
soldats
français
, mutins ou soupçonnés d'espionnage, sont exécutés.
7 novembre 1917 : "Révolution d'Octobre" en Russie
Une
révolution
éclate
en
Russie
le
24
octobre
(selon
l'ancien
calendrier
russe,
7
novembre
selon
le
français)
et
les
Bolchéviques
prennent
le
pouvoir
à
Saint-Pétersbourg.
Ils
négocient
l’armistice
avec
les
empires
centraux
début
décembre.
La
France perd son allié oriental et l’Allemagne peut concentrer ses forces sur le front ouest.
8 janvier 1918 : Les 14 points du président Wilson
Le
président
américain
expose
ses
buts
de
guerre.
Thomas
Woodrow
Wilson
entend
notamment
assurer
la
liberté
de
navigation
sur
les
mers,
garantir
la
naissance
de
nouveaux
États
(Tchécoslovaquie,
Pologne…)
et
créer
une
Société
Des
Nations (SDN).
3 mars 1918 : Traité de Brest-Litovsk entre l'Allemagne et la Russie
Après
la
révolution
d'Octobre,
qui
a
donné
naissance
à
une
république
bolchévique,
la
Russie,
en
pleine
guerre
civile,
signe
un
traité
de
paix
avec
l'Allemagne
à
Brest-Litovsk
(Biélorussie).
Les
Allemands
en
profitent
pour
concentrer
leurs
ultimes
efforts sur le front français. À ce titre, le 23 mars marque le premier tir sur Paris de la "Grosse Bertha", mortier de 420 mm.
Juillet 1918 : Seconde bataille de la Marne
En
Picardie,
puis
en
Champagne,
les
Allemands
cherchent
à
rompre
le
front
avant
l’arrivée
des
troupes
américaines
et
lancent
plusieurs
offensives.
Au
mois
de
juillet
débute
ainsi
la
seconde
bataille
de
la
Marne.
Les
combats
qui
font
rage
dans
le
Nord-Est
de
la
France
tournent
à
l'avantage
des
alliés,
dirigés
par
Foch,
et
qui
lancent
de
nombreuses
contre-offensives.
L'aide
américaine
est
déterminante
:
l'effectif
du
corps
expéditionnaire
commandé
par
le
général
Pershing
s'élève
à
un
million d'hommes en août 1918. Les Allemands ne cessent de perdre du terrain. Le 8 août est un
"jour de deuil pour l'armée allemande"
, selon le chef d'état-major Erich Ludendorff.
11 novembre 1918 : Signature de l'armistice
L'empereur
allemand
Guillaume
II
abdique
le
9
novembre.
Les
généraux
allemands
signent
l'armistice
le
11
novembre,
à
6
heures
du
matin,
dans
la
clairière
de
Rethondes,
en
forêt
de
Compiègne
(Oise).
À
11
heures,
les
hostilités
sont
suspendues.
28 juin 1919 : Signature du traité de Versailles
Le traité de paix entre la République de Weimar et les Alliés est signé le 28 juin, dans la galerie des Glaces du château de Versailles, près de Paris. Il établit les sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne et de ses alliés de la Triple-Alliance.
Le
choix
du
lieu
n'est
pas
un
hasard
:
c'est
là
que
l'empire
allemand
avait
été
proclamé
après
la
défaite
française
de
1870.
La
date
non
plus
n'est
pas
anodine,
puisque
le
28
juin
commémore
le
jour
de
l'assassinat
de
l'archiduc
François
Ferdinand. Cinq ans plus tard, la guerre est officiellement terminée.

© CDHS - SAINT-CLEMENT - 2019
© CDHS - SAINT-CLEMENT - 2019
Bienvenue
sur l’Espace de…
« Joson et La Poux »































Le conflit de la
Grande Guerre
(suite)

Septembre 1915 : Arrière-front des Vosges
Au
front,
une
part
des
vêtements
est
réglementaire,
une
autre
est
aléatoire.
De
bas
en
haut,
les
soldats
portent
des
brodequins,
des
bandes
molletières,
une
culotte,
une
vareuse
et
enfin
une
capote,
portée
par-dessus.
Le
sac,
ou
'barda',
peut peser entre 20 et 30 kilos.
«
Est-ce
que
Papa
ou
Tonton
a
encore
ses
deux
bras?
J’ai
très
peur
pour
mon
père,
qui
est
à
la
guerre.
Tous
les
jours,
je
vois
des
messieurs
bizarres
dans
les
rues.
Ils
n’ont
plus
qu’une
jambe
ou
un
œil
».
Impossible
d’ignorer
les
60
000
mutilés
de
guerre,
qui
étaient
présents
partout.
Les
enfants
comme
Valérie,
vivaient
dans
l’angoisse
permanente que leurs pères ou tontons subissent le même sort.
21 février-18 décembre 1916 : bataille de Verdun
Le
général
Erich
von
Falkenhayn
entend
"saigner
l'armée
française"
.
Un
million
d'obus
pleuvent
en
24
heures
dans
le
secteur
de
Verdun
(Meuse).
Les
Allemands
progressent,
mais
des
poches
de
résistance
se
constituent
dans
les
lignes
arrière
françaises.
Des
hommes
et
du
matériel
sont
acheminés
en
masse
grâce
à
la
"Voie
sacrée"
qui
relie
Bar-le-Duc
à
Verdun.
Ce
terme
emphatique,
référence
à
la
"via
sacra" romaine, est inventé par Maurice Barrès à la fin de la guerre.
La
bataille
de
Verdun
prend
fin
le
18
décembre,
date
à
laquelle
la
plupart
des
positions
perdues
ont
été
réinvesties
par
l’armée
française.
Au
total,
160
000
Français
sont
morts
ou
disparus,
143
000
chez
les
Allemands.
Plus
de
60
millions
d'obus
ont
été
tirés
sur
une
période
de
dix
mois
dans
"l'enfer
de
Verdun".
Printemps 1916 : Secteur de Saint-Jean d'Ormont (Vosges)
On
compte
une
cuisine
roulante
par
compagnie,
soit
150
hommes
environ.
En
première
ligne,
les
soldats
se
contentent
de
pain et de conserves.
***
9 juin 1916 : Changez l'heure de vos
pendules !
Ce
jour-là,
le
Petit
Journal
rappelle
à
l'ensemble
de
la
population
qu'elle
va
devoir
modifier
l'heure
de
ses
pendules.
En
effet,
cette
idée
a
fait
son
chemin
:
évoqué
par
Benjamin
Franklin
dès
1784,
un
changement
d'une
heure
en
été,
pour
vivre
plus
longtemps
avec
la
lumière
du
jour,
permettrait
de
faire
des
économies
d'énergie.
En
temps
de
guerre,
quoi
de
plus
légitime
?
Proposée
dès
1907,
l'idée
est
appliquée
par
l'Allemagne
fin
avril
1916,
aussitôt
suivie
par
l'Angleterre
en
mai, puis par la France en juin.
1er juillet-18 novembre 1916 : Bataille de la Somme
Alors
même
que
l'Est
de
la
France
est
sous
un
déluge
de
feu,
une
offensive
franco-britannique
est
lancée
sur
le
front
allemand
de
la
Somme,
au
nord
de
Paris. Des dizaines de milliers de Britanniques avancent dans le no man's land.
2 juin 1916 : Les Allemands bombardent le terrain de Corcieux
À
Verdun,
cette
bataille
est
la
plus
importante
de
la
guerre.
Pour
la
première
fois
de
l'histoire,
des
chars
d’assaut
(blindés)
sont
utilisés
par
des
militaires
(à
partir
de
septembre,
du
côté
britannique).
Les
combats
durent
jusqu’en
novembre.
Ils
font
environ
300
000
morts
Britanniques
et
Français,
et
près
de
170
000
tués dans l'armée allemande.
6 avril 1917 : Les États-Unis entrent en guerre
Après ces revers, l'Allemagne réenclenche la guerre sous-marine à outrance dans
l'Atlantique, début février. Les attaques visent, entre autres, les navires
marchands américains. Dans son message au Congrès, début avril, le président
Wilson déclare : "La récente conduite du gouvernement impérial allemand n'est,
en fait, rien moins que la guerre contre le gouvernement et le peuple des États-
Unis". Le Congrès américain vote l'entrée en guerre le 6 avril.
16 avril 1917 : Bataille du chemin des Dames et mutineries
Reportée
à
plusieurs
reprises,
"l'offensive
Nivelle"
(du
nom
du
général
qui
dirige
les
opérations)
a
lieu
à
6
heures
du
matin
dans
le
secteur
du
chemin
des
Dames
(Aisne),
par
un
temps
glacial.
C'est
un
échec
sanglant.
Après
une
relance
le
5
mai,
le
constat
du
fiasco
est
définitif
trois
jours
plus
tard.
Le
15
mai,
Nivelle
est
remplacé
par
Pétain
à
la
tête
de
l’armée
française.
Cette
défaite
donne
lieu
aux
premières
mutineries
dans
l'armée
française,
dès
le
17
avril.
Des
unités
complètes,
soit
30
000
à
40
000
soldats,
refusent
de
monter
en
ligne.
Des
dizaines
de
poilus
sont
alors
fusillés.
Au
total,
environ
740
soldats
français
,
mutins
ou
soupçonnés
d'espionnage, sont exécutés.
7 novembre 1917 : "Révolution d'Octobre" en Russie
Une
révolution
éclate
en
Russie
le
24
octobre
(selon
l'ancien
calendrier
russe,
7
novembre
selon
le
français)
et
les
Bolchéviques
prennent
le
pouvoir
à
Saint-
Pétersbourg.
Ils
négocient
l’armistice
avec
les
empires
centraux
début
décembre.
La
France
perd
son
allié
oriental
et
l’Allemagne
peut
concentrer
ses
forces
sur
le
front ouest.
8 janvier 1918 : Les 14 points du président Wilson
Le
président
américain
expose
ses
buts
de
guerre.
Thomas
Woodrow
Wilson
entend
notamment
assurer
la
liberté
de
navigation
sur
les
mers,
garantir
la
naissance
de
nouveaux
États
(Tchécoslovaquie,
Pologne…)
et
créer
une
Société
Des Nations (SDN).
3 mars 1918 : Traité de Brest-Litovsk entre l'Allemagne et la Russie
Après
la
révolution
d'Octobre,
qui
a
donné
naissance
à
une
république
bolchévique,
la
Russie,
en
pleine
guerre
civile,
signe
un
traité
de
paix
avec
l'Allemagne
à
Brest-Litovsk
(Biélorussie).
Les
Allemands
en
profitent
pour
concentrer
leurs
ultimes
efforts
sur
le
front
français.
À
ce
titre,
le
23
mars
marque le premier tir sur Paris de la "Grosse Bertha", mortier de 420 mm.
Juillet 1918 : Seconde bataille de la Marne
En
Picardie,
puis
en
Champagne,
les
Allemands
cherchent
à
rompre
le
front
avant
l’arrivée
des
troupes
américaines
et
lancent
plusieurs
offensives.
Au
mois
de
juillet
débute
ainsi
la
seconde
bataille
de
la
Marne.
Les
combats
qui
font
rage
dans
le
Nord-Est
de
la
France
tournent
à
l'avantage
des
alliés,
dirigés
par
Foch,
et
qui
lancent
de
nombreuses
contre-offensives.
L'aide
américaine
est
déterminante
:
l'effectif
du
corps
expéditionnaire
commandé
par
le
général
Pershing
s'élève
à
un
million
d'hommes
en
août
1918.
Les
Allemands
ne
cessent
de
perdre
du
terrain.
Le
8
août
est
un
"jour
de
deuil
pour
l'armée
allemande"
,
selon le chef d'état-major Erich Ludendorff.
11 novembre 1918 : Signature de l'armistice
L'empereur
allemand
Guillaume
II
abdique
le
9
novembre.
Les
généraux
allemands
signent
l'armistice
le
11
novembre,
à
6
heures
du
matin,
dans
la
clairière
de
Rethondes,
en
forêt
de
Compiègne
(Oise).
À
11
heures,
les
hostilités
sont suspendues.
28 juin 1919 : Signature du traité de Versailles
Le
traité
de
paix
entre
la
République
de
Weimar
et
les
Alliés
est
signé
le
28
juin,
dans
la
galerie
des
Glaces
du
château
de
Versailles,
près
de
Paris.
Il
établit
les
sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne et de ses alliés de la Triple-Alliance.
Le
choix
du
lieu
n'est
pas
un
hasard
:
c'est
là
que
l'empire
allemand
avait
été
proclamé
après
la
défaite
française
de
1870.
La
date
non
plus
n'est
pas
anodine,
puisque
le
28
juin
commémore
le
jour
de
l'assassinat
de
l'archiduc
François
Ferdinand. Cinq ans plus tard, la guerre est officiellement terminée.